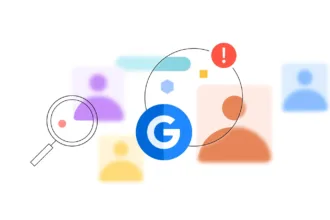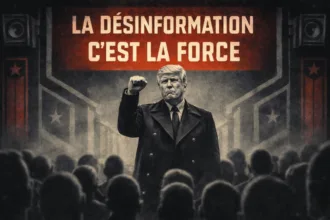Aux États-Unis, la folie de l’intelligence artificielle a pris des proportions démesurées. Ce ne sont plus seulement les logiciels qu’on bâtit, mais tout un pays qui se transforme en chantier numérique. Partout, on érige des centres de données à perte de vue, des complexes si vastes qu’on les distingue depuis l’espace. Ces infrastructures avalent l’électricité comme des villes entières, peu importe la source. Le vent et le soleil ont été mis de côté, place au gaz, au charbon et à tout ce qui brûle. Dans certains cas, on recycle même des réacteurs d’avion pour produire l’énergie nécessaire à cette démesure. L’Amérique se convainc qu’il faut foncer, peu importe le coût, comme si l’avenir dépendait d’un amas de serveurs qui tournent sans relâche.
Sur le plan économique, c’est la même frénésie. La valeur des entreprises du secteur explose, souvent sans lien avec leurs résultats réels. On spécule sur la promesse d’un monde nouveau, comme on l’a déjà fait avec l’internet au tournant du siècle. La différence, cette fois, c’est l’ampleur : des montants colossaux, des valorisations qui dépassent tout ce qu’on a vu, et une croyance quasi religieuse que la technologie finira bien par tout résoudre. En coulisse, certains craignent déjà que cette bulle, gonflée à coups de milliards, ne finisse par éclater.
Au cœur de cette bulle, il y a les puces électroniques, devenues le nouvel or numérique. Leur production ne suffit plus à suivre la demande, et chaque annonce de livraison fait grimper la valeur des fabricants comme un 6/49 gagnant. Les marchés se nourrissent de cette rareté, convaincus que la puissance de calcul est la clé de tout progrès. Pendant ce temps, les entreprises qui consomment ces puces accumulent les pertes. Elles brûlent du capital à un rythme effréné, sans modèle d’affaires solide, mais avec une confiance inébranlable que « l’intelligence » finira bien par se monétiser. Tout cela rappelle étrangement la période où l’on croyait que chaque site web allait révolutionner le monde.
Les investisseurs, eux, continuent d’y croire. Tant que les titres montent, personne ne veut regarder de trop près ce qu’il y a derrière les chiffres. Des fonds entiers sont injectés dans des projets dont la rentabilité repose sur des scénarios futuristes, voire hypothétiques. L’économie réelle, celle qui emploie, produit et nourrit, devient un simple décor. L’IA, présentée comme une promesse d’efficacité, semble plutôt alimenter un grand cycle d’auto-illusion où l’argent finance surtout l’idée d’un futur rentable.
À mesure que l’euphorie s’étend, les chiffres deviennent irréels. Les entreprises du secteur signent des ententes à mille milliards comme si elles achetaient des bonbons. Les promesses d’investissement dépassent maintenant ce qu’un État souverain engagerait pour une guerre ou un plan de reconstruction. On parle de centaines de milliards pour bâtir des réseaux de calcul, des usines à puces, des mégacentres énergétiques, tout cela pour nourrir un modèle d’affaires dont les revenus réels ne couvrent même pas les intérêts de la dette. C’est l’économie de la croyance : on mise sur la promesse de l’intelligence artificielle comme d’autres misaient jadis sur la ruée vers l’or.

Mais derrière cette effervescence financière se cache une réalité plus terre à terre : la matière. La technologie évolue si vite que tout devient obsolète avant d’être amorti. Construire un centre de données aujourd’hui, ce n’est pas ériger une papetière dont les machines dureraient un demi-siècle. Ces usines numériques ont une espérance de vie inférieure à cinq ans. Chaque génération de puces promet plus de puissance et un peu moins d’énergie consommée, mais impose le remplacement de millions de serveurs encore fonctionnels. Une simple armoire de serveurs peut coûter trois millions de dollars, et les mégacentres en comptent des milliers. C’est une spirale de dépenses et de ressources, un cycle d’usure accéléré par l’idée même de progrès.
Certains redoutent que l’intelligence artificielle détruise l’humanité en prenant le contrôle des infrastructures vitales ou en déclenchant des guerres à la « Terminator ». Le danger est sans doute plus banal, mais tout aussi inquiétant. Ce n’est pas la machine qui menace de nous anéantir, c’est l’avidité humaine.
À force de poursuivre une illusion numérique, les géants du secteur pourraient bien épuiser les capitaux, l’énergie et les ressources naturelles qui soutiennent nos sociétés avant même que cette fameuse intelligence ne serve à quoi que ce soit.
Ce système repose sur un équilibre fragile : quelques géants se partagent le gâteau et s’endettent les uns envers les autres. Si l’un d’eux vacille, tout l’édifice menace de s’écrouler. Les marchés, aveuglés par l’enthousiasme, ferment les yeux sur ce risque. Ils préfèrent la narration du progrès à la réalité des bilans. C’est la nouvelle religion du capital : croire que l’IA rachètera l’économie, même si personne ne sait encore ce qu’elle rapporte.